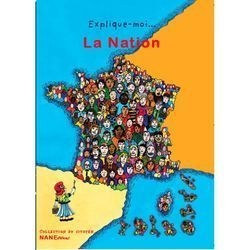par Jean-Pierre Durand
Lien d'origine:link
Le concept d’aliénation créé par Marx à propos du rapport que l’ouvrier entretient avec son travail a tellement été malaxé depuis le XIXe siècle qu’il mérite un retour aux sources, y compris en le rapprochant d’autres formulations connotées différemment comme celle de « servitude volontaire ». Pourtant le débat doit porter sur l’actualité du concept lui-même, sur sa validité dans le capitalisme présent, financiarisé et globalisé. En effet, si l’usage du terme apparaît beaucoup moins fréquent que dans les années 1960-70 dans les textes critiques, c’est essentiellement parce que, d’une part, l’inflation de son utilisation l’avait discrédité sinon disqualifié et, d’autre part, parce que la conceptualisation marxiste ou néo-marxiste – pour ne pas dire l’approche marxiste tout simplement – doit faire face à l’autisme d’une grande partie de l’intelligentsia actuelle.
2 Pour nous, la question se pose ainsi : n’est-il pas temps de réhabiliter le concept d’aliénation dans le modèle productif aprèsfordien, tel que nous le vivons aujourd’hui ?N’est-il pas le concept le plus précis qui rende compte de l’enfermement dans lequel se trouvent la plupart des salariés dans leur activité de travail ? N’est-il pas au fondement des contradictions dans lesquelles se meuvent nombre de cadres ? Pour être clair, dans ce texte nous traiterons essentiellement de l’aliénation dans le procès de travail, caractérisé par les rapports de production capitalistes de ce début du XXIe siècle. Ainsi, nous n’analyserons ni le processus de financiarisation de l’économie globalisée, ni les restructurations des entreprises, ni la question de l’emploi (sauf dans ses effets d’« armée de réserve » sur les salariés occupés), ni les thèmes de la vie hors travail, pourtant bénéfiques à tout développement théorique sur l’aliénation… L’objectif est de concentrer l’analyse sur le procès de travail et sur ce que nous dénommons lacombinatoire productive, c’est-à-dire la combinaison du procès de travail lui-même avec son contexte immédiat, à savoir la restructuration de l’entreprise à partir des principes de son intégration fonctionnelle et de la constitution de la firme étendue (ou réticulaire) – autant de processus liés à la fois à la financiarisation de l’économie, c’est-à-dire à de nouvelles exigences des actionnaires, à une concurrence exacerbée dans les pays de l’OCDE où la croissance économique reste faible et à l’expansion des technologies de l’information et de la communication (TIC).
3 Après un court retour aux sources du concept d’aliénation chez Marx, nous proposerons quelques illustrations du fonctionnement du concept dans des situations actuelles. Ce sera alors le moment de comprendre en quoi il est un outil essentiel pour expliquer les régimes de mobilisation du travail dans le modèle après-fordien et surtout pourquoi ces régimes rencontrent quelques succès malgré des résistances.
4 Pour synthétiser les apports de Marx sur le rapport salarial capitaliste, on peut opposer l’égalité juridique des positions des échangeurs (l’un offre sa marchandise force de travail que l’autre lui achète) à l’inégalité de l’échange économique : au-delà du seul procès de production de la plus-value, l’inégalité réside dans le fait que l’offreur doit retourner chaque jour vendre sa force de travail puisqu’il ne dispose ni des moyens de production ni des moyens de subsistance. C’est le fondement même de la reproduction du rapport de production capitaliste qui, comme l’écrit Marx, est un résultat plus important que la production matérielle des marchandises. Et dans ce rapport de production capitaliste, l’ouvrier abandonne le résultat de son travail : « Pour autant que le procès de production n’est que procès de travail, l’ouvrier y consomme les moyens de production comme de simples aliments du travail ; en revanche, pour autant qu’il est aussi procès de valorisation, le capitaliste y consomme la force de travail de l’ouvrier en s’appropriant le travail vivant comme sang vital du capital. La matière première et l’objet du travail, en général, ne servent qu’à absorber le travail d’autrui, l’instrument de travail faisant office de conducteur, de véhicule dans ce procès d’absorption. En incorporant à ses éléments matériels la force de travail vivante, le capital devient un monstre animé et se met à agir “comme s’il était possédé par l’amour” » [1] Marx, Un Chapitre inédit du Capital, Paris, UGE 10/18,1971,...[1].
5 Ainsi, alors que la valeur d’usage de la force de travail est de produire de la valeur – plus de valeur qu’elle n’en contient elle-même –, cette valeur produite est aliénée pour le vendeur, au grand bénéfice de l’acheteur. Ainsi, l’ouvrier crée une valeur, mais une valeur étrangère à lui-même puisqu’elle lui échappe en tant que travail cristallisé sur un objet qui ne lui appartient pas, durant un temps de travail qu’il a cédé au capitaliste. « En réalité, l’acheteur de la capacité de travail n’est que la personnification du travail objectivité dont une fraction est cédée à l’ouvrier sous forme de moyens de subsistance pour que la force vivante du travail s’incorpore à l’autre fraction et qu’au moyen de cette incorporation le capital se conserve tout entier et croisse même au-delà de sa masse initiale. Ce n’est pas l’ouvrier qui acquiert les moyens de subsistance et de production, ce sont les moyens de subsistance qui achètent l’ouvrier, afin d’incorporer sa force de travail aux moyens de production » [2] Ibid., p. 165 (souligné par nous).[2]. Cette dernière formulation qui peut apparaître paradoxale constitue l’un des renversements paradoxaux auxquels Marx nous a habitués.
6 De même, si le produit du travail est aliéné, la production elle-même devient l’aliénation en acte. Autrement dit, tout comme l’idéologie n’est pas le résultat de la domination mais lui est inhérente, l’aliénation n’est pas seulement le produit du travail, elle est intrinsèque au processus productif, c’est-à-dire à l’acte de travail salarié lui-même dans le capitalisme. Alors, on peut soutenir que l’acte de travail est « extérieur à l’ouvrier, que le travail dans lequel l’homme s’aliène est un travail de sacrifice de soi, de mortification. Enfin, le caractère extérieur à l’ouvrier du travail apparaît dans le fait qu’il n’est pas son bien propre, mais celui d’un autre, qu’il ne lui appartient pas, que dans le travail l’ouvrier ne s’appartient pas lui-même, mais appartient à un autre » [3] K. Marx, Les Manuscrits de 1844, Paris, Editions sociales,...[3]. Dire que « l’ouvrier appartient à un autre », c’est décrire le servage ou l’esclavagisme et non le capitalisme. Marx n’avait pas encore distingué la force de travail de l’ouvrier : le capitaliste n’achète pas le travailleur mais l’usage de la force de travail de l’ouvrier durant un temps défini. Lequel ouvrier ne peut construire librement son œuvre puisqu’il ne dispose pas des moyens de travail : « L’ouvrier met sa vie dans l’objet. Donc plus cette activité est grande, plus l’ouvrier est sans objet. Il n’est pas ce qu’est le produit de son travail. Donc plus ce produit est grand, moins il est lui-même. L’aliénation de l’ouvrier dans son produit signifie non seulement que son travail devient un objet, une existence extérieure, mais que son travail existe en dehors de lui, et devient une puissance autonome vis-à-vis de lui, que la vie qu’il a prêtée à l’objet s’oppose à lui, hostile et étrangère » [4] Ibid., p. 58.[4]. Plus encore, nous pouvons passer de l’aliénation de la chose à l’aliénation de soi[5] Ibid., p. 61.[5]. En effet, si le processus de production ou l’acte de travail dans le capitalisme aliène la chose (le résultat du travail), il aliène aussi le support de la force de travail (l’ouvrier).
7 Si Marx a travaillé sur l’échange marchand entre ouvrier et capitaliste, c’est bien entendu le rapport salarial capitaliste qu’il a analysé dans son essence, entre celui qui ne dispose que de sa force de travail, physique et intellectuelle, et le capitaliste détenteur des moyens de production et des moyens de subsistance. Du point de vue qui nous intéresse, à savoir l’élucidation de la nature et du processus d’émergence et de fonctionnement de l’aliénation, les analyses de Marx relatives à l’aliénation du travail ouvrier puis de l’ouvrier lui-même concernent l’ensemble des salariés dans les rapports de production capitalistes. Car c’est bien de l’essence du rapport salarial capitaliste dont parlait Marx en posant l’ouvrier comme privé de ses moyens de production et de ses moyens de subsistance tout comme l’est tout salarié dans le capitalisme contemporain [6] On peut exclure ici les salariés bénéficiaires de stock...[6]. Ce qui nous conduit à interpréter l’aliénation dans le travail salarié aujourd’hui.
De l’aliénation à sa dénégation 8 L’une des caractéristiques essentielles de l’aliénation est sa dénégation, c’est-à-dire le refus par la victime de percevoir sa condition telle qu’elle est. En glissant des rapports d’exploitation aux rapports de domination dans les années 1970, A. Touraine n’en montre pas moins, pour les dominés, la nécessité pour exister et pour accepter leurs conditions de nier cette domination et cette aliénation : « L'aliénation suppose l'adoption par la classe dominée d'orientations et de pratiques sociales et culturelles déterminées par les intérêts de la classe supérieure et qui masquent les rapports de classes en posant l'existence d'une situation sociale et culturelle reconnue comme le champ commun à tous les acteurs et définissable sans recours aux rapports de domination. L'aliénation est d'abord la négation de la domination » [7] A. Touraine, Production de la société, Paris, Le Seuil,...[7].
9 La négation de l’aliénation et de la domination peut avoir lieu à travers deux processus entrelacés. D’une part, à travers une impossibilité de percevoir cette aliénation ou, d’autre part, à travers un rejet quelque peu conscient de celle-ci pour satisfaire des exigences immédiates.
10 Nombre de salariés ne perçoivent ni la domination ni l’aliénation parce que les représentations dominantes – celles de la classe dominante – les masquent sous les discours de l’égalité des chances, de l’équité ou des lendemains toujours meilleurs à partir d’un projet social que chacun partage « naturellement » : c’est la thèse tourainiene du modèle culturel – celui du « développement » dans nos sociétés – que les dominés reprennent à leur compte puisqu’il porte l’espoir de jours meilleurs pour eux-mêmes et pour leur descendance. Selon A. Touraine, pour que le modèle culturel vive dans les consciences, celles-ci se projettent dans l’avenir et doivent nier l’immédiateté de leurs conditions de salariés, à savoir l’appropriation par le capital du fruit de leur travail, en particulier au-delà de la valeur même de la force de travail. Une autre approche, celle de C. Castoriadis, veut que « le sujet, [soit] dominé par un imaginaire vécu comme plus réel que le réel, quoique non su comme tel, précisément parce que non su comme tel. Alors, l’essentiel de l’hétéronomie – ou de l’aliénation, au sens général du terme – au niveau individuel, c’est la domination par un imaginaire autonomisé qui s’est arrogé la fonction de définir, pour le sujet et la réalité et son désir » [8] C. Castoriadis, L’Institution imaginaire de la société,...[8]. Ainsi, si le sujet est dominé par le discours de l’Autre, qui ne se dit pas comme tel, la fin de l’aliénation passe par la négation du discours de l’Autre, laquelle est impossible puisque le sujet, pour exister, requiert justement le discours de l’Autre. On l’a compris, dans la plupart des analyses, la négation de l’aliénation appartient au processus de sa construction : d’où sa dénégation largement partagée par la plupart des acteurs, tant que la lente déconstruction heuristique n’est pas entamée et surtout achevée.
11 Par ailleurs, des salariés qui auraient conscience du processus aliénant le résultat de leur travail, intrinsèque aux rapports de production capitalistes, peuvent le nier parce que sa destruction ou son dépassement leur paraissent des tâches démesurées. En l’acceptant et en « s’en arrangeant » plus ou moins consciemment, ils le nient explicitement pour accorder leurs pratiques à leurs positions ou déclaration verbales. Il apparaît que cette situation tend à se développer dans le salariat contemporain, en particulier dans l’encadrement [9] Cf. les travaux de Bouffartigue (par exemple Les Cadres,...[9], mais pas seulement puisqu’on la rencontre aussi parmi les employés et les ouvriers à travers la perception du décalage croissant qu’ils perçoivent (en s’en accommodant) entre les annonces managériales et les faits concrets du procès de travail. Nous sommes donc assez loin de la conscience de l’aliénation du travail et du travailleur telle qu’elle a été mise en évidence par Marx, en particulier parce que le terme d’aliénation n’est pas – encore ? – utilisé pour dénommer ce décalage. Il n’en reste pas moins la forme moderne de l’aliénation.
Nouveau modèle productif et implication contrainte 12 L’appellation nouveau modèle productif (ou après-fordien), très insatisfaisante conceptuellement, signifie seulement que de profonds changements sont intervenus dans l’organisation de la production des biens et des services et dans l’organisation du travail depuis la fin des années 1980, même si la production de masse reste dominante, seulement amendée d’une différenciation relative des produits et des services (notion de production de masse flexible). Cette désignation de nouveau modèle productif tiendra le temps qu’on lui trouve une formulation adéquate et synthétique, comme le fut d’une certaine manière celle de fordisme, qui associait une régulation macro-sociale (rôle des syndicats et de l’État) à une organisation spécifique du travail (division du travail et parcellisation des tâches) et à un mode particulier de mobilisation des travailleurs par les augmentations salariales. Lorsque le modèle fordien a perdu sa cohérence et ses régulations leur efficacité, les nations occidentales sont entrées dans une période de crise (1975-1985) caractérisée par une stagnation économique et surtout par une baisse de rentabilité du capital. Depuis, le capitalisme s’est transformé au niveau macro-économique mais a surtout réussi à augmenter considérablement la productivité du travail, quelque peu grâce aux technologies de l’information mais surtout par des réorganisations de la production et du travail. C’est de celles-ci que nous parlerons maintenant.
13 En effet, les directions d’entreprise ont su inventer de nouvelles cohérences, semblables à celles du modèle fordien, dans des conditions de très faible croissance économique (en particulier en Europe ou au Japon), avec une stagnation voire une réduction des salaires pour renouer avec de fortes rentabilités pour les capitaux investis. Pour situer le modèle productif émergent, il faudrait aussi prendre en compte la réduction du nombre d’emplois dans les pays de l’OCDE et les délocalisations des activités vers les pays à faible coût de main-d’œuvre mais, dans le cadre de cet article, nous nous focaliserons sur le procès de travail pour saisir les nouvelles voies de l’aliénation des salariés.
14 La nouvelle cohérence productive repose sur la mise en adéquation des trois composantes du procès de travail : l’organisation de la production en général, l’organisation du travail proprement dite et le régime de mobilisation des salariés [10] Voir pour un développement argumenté de ces thèses...[10]. Pour ce qui est de la réorganisation de la production, la généralisation du flux tendu signifie que chaque segment de production des biens et des services est mis en dépendance directe du segment amont et du segment aval en faisant disparaître les stock-tampons entre ces segments. Hier, dans une situation où les coûts importaient moins qu’aujourd’hui, ceux-ci laissaient une certaine maîtrise des temps et de leur organisation aux salariés. Aujourd’hui, il faut comprendre la fin des stocks-tampons comme une volonté managériale de mettre en mouvement permanent la matière ou l’information pour bien sûr accroître la rotation du capital, mais aussi d’activer les hommes pour accroître la productivité du travail : le flux tendu, principe selon lequel si un segment s’arrête tout s’arrête, a pour but de fragiliser la production des biens et des services afin que les hommes se sentent mobilisés en permanence, s’activent en permanence – dans un contexte de réduction des coûts de main-d’œuvre donc du nombre de salariés – pour ne pas rompre le flux. Le lecteur peut observer, pour s’en convaincre, la restauration rapide, les banques, les hypermarchés, les hôpitaux, le transport aérien, les plateformes logistiques de la grande distribution, les centres d’appels téléphoniques et bien sûr toute l’industrie à partir de ce qu’il a entendu sur le juste-à-temps dans l’industrie automobile. Toutes les formulations telles que les relations clients-fournisseurs, le management par projet, le groupware, le workflow [11] Il s’agit d’autant de techniques organisationnelles...[11], etc. recouvrent ce paradigme du flux tendu à travers lequel tout salarié est mobilisé à chaque seconde pour satisfaire les demandes de l’étape aval afin de maintenir le flux continu d’écoulement de la matière (industrie) ou de l’information (industrie, services [12] On se reportera au même ouvrage cité ci-dessus pour...[12] ). Ce paradigme du flux tendu contient en lui-même les principes de mobilisation des salariés puisqu’ils doivent conformer leur activité de travail aux exigences du système global de production : exécuter les tâches ou tenir des engagements afin de ne pas stopper le flux productif. D’où la première dimension de ce que nous avons dénommé l’implication contrainte des salariés qui, à partir du moment où ils ont accepté le principe du flux tendu – mais peuvent-ils y échapper ? –, sont contraints de s’impliquer pour maintenir tendu le flux. Ici, c’est dans le principe productif qu’est inscrit l’implication contrainte : il n’y a pas lieu de multiplier les hiérarchies [13] On peut même les réduire ! D’où tous les discours managériaux...[13] puisque, « naturellement », les salariés répondent aux exigences techniques, intellectuelles, etc., de l’appareil productif.
Travail en groupe et évaluation des comportements 15 Au regard de la complexité des systèmes de production et surtout de leur intégration, la surveillance des segments productifs ou le travail à l’intérieur de ceux-ci est devenu collectif : ce n’est plus un homme par machine comme durant la période fordienne, mais un collectif de salariés pour un segment productif. D’où le principe du travail en groupe autour d’un animateur ou d’un moniteur qui se substitue à l’équipe fordienne avec son chef. L’animateur – quelque nom qu’il possède – n’a pas de pouvoir hiérarchique sur son groupe et organise le groupe (gestion des absences, rotation des postes, plan de formation, etc.). La polyvalence est l’un des piliers du travail en groupe, puisqu’elle permet l’interchangeabilité des salariés en cas d’absence ou en cas de besoin immédiat. D’une certaine façon, le groupe peut apparaître autonome, mais il l’est dans les latitudes laissées par les outils socio-techniques de gestion de la qualité, du kaïzen (amélioration continue), de la TPM (maintenance préventive), etc. Or tous ces outils construisent de nouvelles procédures qui enserrent les salariés dans un espace créatif à l’amplitude toujours plus étroite, limitant considérablement leur autonomie réelle [14] Ce qui n’empêche pas l’existence de jeux sociaux et...[14]. Dans le groupe de travail, la main-d’œuvre étant réduite au minimum par rapport aux tâches à accomplir, les salariés vivent sous une certaine pression de l’appareil productif auquel il faut répondre immédiatement pour ne pas arrêter le flux : la pression des pairs est considérable sur chaque individu. Il s’établit des sortes de normes moyennes de travail (en quantité et en qualité) dans et par le groupe lui-même et celui qui se situe trop en deçà – ou trop au-delà dans une stratégie individualiste de carrière – est sanctionné par le groupe lui-même : nous pouvons rapporter des dizaines de situations où c’est le groupe lui-même et non la hiérarchie qui demande l’exclusion d’un des membres... Ce n’est donc pas de harcèlement moral dont il faut parler ici car il n’y a pas – ou très peu – d’individus pervers dans le groupe, mais d’entretien calculé du stress pour faire vivre le groupe au coût le plus bas, c’est-à-dire avec le minimum de personnes. L’implication contrainte dont nous parlions précédemment est évidemment le concept qui caractérise le mieux la vie au quotidien des groupes de travail.
16 Enfin, la fragilité du système – autant technique qu’humaine comme on vient de le voir – exige un contrôle permanent des travailleurs. Mais ici, si le contrôle direct du travail peut être énormément allégé (puisqu’il a lieu par l’appareil productif lui-même ou par le groupe des pairs), il est nécessaire de s’assurer de la loyauté des salariés afin qu’ils ne remettent pas en cause le principe du flux tendu. D’où la mise en œuvre généralisée de l’évaluation individuelle, au moment du recrutement bien sûr mais aussi tout au long de la carrière professionnelle. Le management n’a plus besoin d’évaluer le résultat du travail (en particulier quantitatif) puisque les appareils productifs dictent les cadences du travail des hommes (depuis le dépannage d’une installation jusqu’à la fourniture à l’instant fixé d’un segment de logiciel dans un atelier de logiciels ou d’une partie de projet dans le management par projet) : il s’agit d’évaluer les comportements, la capacité individuelle à travailler en groupe et bien sûr la loyauté vis-à-vis du principe du flux tendu et plus généralement de l’entreprise ou de l’organisation (cas de l’administration publique, des hôpitaux, etc.). L’analyse fine des grilles d’évaluation ou des guides d’entretien individuel montre clairement comment les concepteurs des grilles privilégient la notation des comportements individuels au détriment des seuls résultats du travail. En ce sens, la définition par le Medef des compétences – qui se substituent aux qualifications dans le vocabulaire managérial – illustre bien la rupture avec la période fordienne : « La compétence professionnelle est une combinaison de connaissances, savoir-faire, expériences et comportements, s'exerçant dans un contexte précis ; elle se constate lors de sa mise en œuvre, en situation professionnelle, à partir de laquelle elle est validable. C’est donc à l'entreprise qu'il appartient de la repérer, de l'évaluer, de la valider et de la faire évoluer » [15] CNPF, Journées internationales de la Formation. Objectif...[15]. Le passage du vocable de qualifications à celui de compétences qui introduit, au-delà des connaissances et des savoir-faire, la validation des comportements marque la rupture avec la période fordienne.
17 L’institutionnalisation de l’évaluation des comportements des salariés diffère de la promotion « à la tête du client » qui caractérisait la période précédente. Ce n’est pas tant l’utilisation des résultats des évaluations (pour la promotion ou pour l’attribution de primes individualisées) qui compte ici que la construction d’une norme comportementale construite par le management et à laquelle les salariés vont se conformer pour conserver leur emploi, dans une situation de fort sous-emploi. Plus encore, dans certaines entreprises et organisations s’instaure une émulation, voire une compétition entre salariés pour répondre mieux encore aux attentes managériales en matière de comportement [16] Cf. J.-P. Durand et P. Stewart « La transparence sociale...[16]. A nouveau, le concept d’implication contrainte caractérise bien la situation du salarié obligé de se montrer engagé sur les objectifs de l’entreprise qui l’emploie – ou qui va le recruter.
Implication contrainte et aliénation subjective 18 L’avènement de ce modèle productif après-fordien doit être salué par la cohérence retrouvée qu’il organise dans les trois sous-champs que nous venons de présenter : parce qu’il organise la dimension collective du travail, d’une part, et parce que les pairs imposent volontairement (ou « naturellement », au sens où c’est la norme et que l’on ne pense pas à faire autrement) à chaque individu le respect d’un volume de travail, d’autre part, le travail en groupe est parfaitement cohérent avec les exigences techniques et économiques du principe du flux tendu. Enfin, le modèle de la compétence qui privilégie l’évaluation individuelle des comportements sur tout autre critère d’évaluation du travail vérifie – ou anticipe le fait – que les acteurs du flux tendu correspondent bien à ses exigences (instantanéité des réactions des salariés ou effectivité de leurs engagements). En utilisant le concept d’implication contrainte, qui se substitue à celui d’implication salariale caractérisant la période fordienne, nous soulignons aussi qu’à la différence des décennies précédentes, l’implication se fait sans contrepartie, sauf celle de conserver son emploi – pas toujours durablement d’ailleurs. C’est en ce sens qu’elle est contrainte. Cet oxymore, pour expliciter le concept dans le vocable actuel, nous paraît très heuristique parce qu’il interroge de façon renouvelée le rapport salarial capitaliste en montrant comment est résolue l’incomplétude du contrat de travail : si l’employeur achetait hier la force de travail durant un temps donné, il n’avait aucune garantie sur la qualité de son usage ; avec la construction de l’implication contrainte, qui mobilise la subjectivité du salarié, l’employeur dispose de garanties qu’il n’avait pas.
19 D’un autre point de vue, celui du salarié, ce dernier est contraint d’accepter sa condition, de nier sa dépendance ou sa domination dans le rapport inégal qu’il entretient avec son employeur et plus encore de prouver un engagement sans faille sur les objectifs de ce dernier. Alors l’aliénation fonctionne à deux niveaux complémentaires, pourrait-on dire : d’une part, à travers l’aliénation objective du salarié par rapport au capital qui l’emploie puisqu’il cristallise durant son temps de travail une valeur – et une survaleur – sur un objet de travail qui ne lui appartient pas ; d’autre part, à travers une aliénation subjective il doit faire preuve d’un engagement, d’une mobilisation de son être (le savoir-être par exemple) sur les objectifs de son employeur, c’est-à-dire qu’il doit s’engager à cristalliser durant le temps de travail salarié, toujours sur le même objet de travail qui ne lui appartient pas, une valeur sans cesse supérieure dont l’accroissement tient à la mobilisation volontaire – mais obligée ou contrainte – de toutes ses capacités physiques et aujourd’hui surtout intellectuelles. D’où aussi la possibilité de recourir à la notion de servitude volontaire pour rendre compte de cette soumission et de cet asservissement sinon volontaire, du moins accepté et quelquefois montré avec ostentation par le salarié qui souhaite conserver son emploi, condition pour maintenir sa dignité dans la société capitaliste.
20 Démontrer qu’il y a une dimension subjective à l’aliénation du salarié dans le rapport salarial capitaliste contemporain, dimension qui pouvait exister mais qui n’était pas nécessaire pour la majorité des salariés dans la phase précédente du développement capitaliste, c’est assurément montrer que nous vivons un changement (ni une rupture ni un changement de nature !) dans l’exploitation capitaliste. Certains pourront tisser un lien entre cette mobilisation de la subjectivité et le développement de la dimension intellectuelle du travail depuis trois décennies à travers ce qu’ils appellent la « révolution informationnelle »[17] Cf. J. Lojkine, La Révolution informationnelle, Paris,...[17]. Pour nous, cette subjectivation de l’aliénation tient d’abord à la permanence de la crise de l’accumulation du capital, provisoirement résolue par un accroissement sans précédent de la productivité du travail qui a lieu, entre autres, à travers une extraordinaire mobilisation de la subjectivité des salariés.
21 Il est donc temps d’interroger le sens de cette mobilisation croissante de la subjectivité des salariés, de leur implication contrainte, soit aussi des nouvelles formes d’aliénation du travail qu’ils vivent. N’assiste-t-on pas à un divorce croissant entre le sens immédiat que l’on peut donner à son activité dans l’emploi salarié – y compris à partir de l’envie de faire [18] Cf. P. Ughetto, « La rationalisation vue de l’activité...[18] cosubstantive à l’activité de travail, même salarié – et le travail réel que l’on doit effectuer ? Ce divorce ne serait-il pas la manifestation des formes actuelles de l’aliénation du travail dans le capitalisme contemporain ? On peut ramasser les comportements aliénés actuels autour de deux grands ensembles : l’auto-construction d’une carapace de justifications pour mieux vivre son aliénation, d’une part, et la résistance plus ou moins consciente aux injonctions managériales, d’autre part.
L’auto-construction d’un bouclier de justifications de ses pratiques 22 Pour la plupart des salariés d’exécution, l’implication contrainte apparaît comme une situation d’impasse, incontournable, qu’ils vivent plus ou moins bien mais dont ils s’accommodent parce qu’elle ne les engage pas dans des rapports sociaux complexes, comme c’est le cas pour le personnel d’encadrement ou pour les commerciaux. Dans une banque, par exemple, les chargés de clientèles sont-ils des conseillers qui cherchent à rendre service au client, donc qui recherchent l’intérêt de ce dernier dans la multiplicité des produits ou bien des commerciaux qui, pour être mieux évalués, vont placer un maximum de produits ou taxer tant et plus les comptes des clients (découverts, pénalités, commissions diverses) ? Chaque agent s’interroge à sa manière, selon sa trajectoire personnelle, sur ces choix professionnels [19] S. Geoffroy, Travail et éthique : le conseiller clientèle...[19]. Nombre d’entre eux s’inventent des points d’équilibre pour dénier la contradiction qu’ils vivent au jour le jour.
23 Le personnel d’encadrement doit fixer des objectifs à ses subalternes dont il connaît le caractère quelquefois arbitraire et dont il sait qu’ils ne s’accompagnent que très rarement d’une politique de moyens pour les atteindre, puisqu’il est lui-même victime du même phénomène. La règle de trois pour fixer les objectifs de résultat comme ceux de réduction des effectifs est le moyen le plus primaire de leur répartition entre services mais reste le plus usité. Le personnel des DRH vit en général assez mal les périodes de crise, en particulier les suppressions d’emplois, mais quelle est sa marge de manœuvre en dehors de la démission ?
24 Pour vivre ces injonctions contraires aux principes existentiels qui peuvent être les leurs, ces catégories de salariés – et bien d’autres placées dans des situation semblables – empruntent aux idées reçues (c’est-à-dire à l’idéologie dominante) ou s’inventent des causes suprasociales, systémiques dont ils sont victimes comme les autres. Ce peut être la production d’une haute valeur actionnariale pour empêcher toute OPA, comme nous l’avons entendu dans une grande entreprise électrique ; ce peut être la défense, par des cadres d’une grande entreprise publique, d’une politique des résultats en remplacement de l’ancienne politique des moyens pour justifier la suppression de milliers d’emplois, etc. Dans bien d’autres situations, chaque élu (dans une collectivité territoriale, dans une université) peut se retrouver – malgré lui, pourrait-on dire – en train de défendre une politique d’austérité pour faire vivre son institution alors que des masses de capitaux se promènent d’une Bourse à l’autre en quête d’une valorisation qui peut s’évanouir en quelques jours, comme en 1997.
25 Ici l’emprunt, l’invention puis l’appropriation d’un principe suprasocial permet aux salariés concernés de construire, sans même se l’avouer, un bouclier ou une carapace contre les rappels de leur conscience, susceptible de les inviter à s’auto-imposer d’autres pratiques. Par ce mécanisme, les intéressés transforment le mal être de leur condition de salarié doublement aliéné (à travers le salariat, d’une part, et à travers leurs pratiques contraires à leur éthique, d’autre part) en un bien-être, au moins relatif [20] Cf. G. Flocco, La Mobilisation productive des cadres...[20]. Il ne s’agit pas ici de cautionner les thèses durational choice, mais il s’avère que sans calcul de leur intérêt personnel, nombre de salariés sont conduits à épouser les valeurs économiques et gestionnaires dominantes – dominantes au sens où ce sont aussi celles de leurs dirigeants en plus d’être celles de la classe dominante ! – parce qu’elles sont les plus immédiatement accessibles pour atteindre les objectifs simples assignés par la société capitaliste : un statut respectable fondé sur une puissance de consommation ostentatoire. Dit autrement, la construction du bouclier par l’intériorisation des normes gestionnaires dominantes bat en brèche, chez la plupart des salariés placés sur des trajectoires professionnelles ascendantes, toute velléité de faire valoir des principes altruistes de justice sociale. L’acceptation de leur condition aliénée leur apparaît d’autant moins onéreuse par rapport à toute action politique ou syndicale, que la carapace des valeurs gestionnaires dominantes a aussi pour objet de dénier leur aliénation.
Les poches de résistance à l’aliénation 26 Les résistances individuelles sont presque toujours vouées à l’échec parce qu’elles sont contrariées par la puissance systémique des comportements des autres acteurs qui se plient aux règles dominantes. Plus encore, elles sont très souvent le fait d’individus qui, après avoir accepté sinon mis en œuvre les règles nouvelles de la domination, en sont les premières victimes (maladie, âge). Non seulement leur freinage reste incompris des autres salariés, mais celui-ci contribue à accroître leur isolement jusqu’à la perte de leur emploi. Ainsi, la prise de conscience de ce type d’aliénation (la non-maîtrise de sa trajectoire professionnelle), parce qu’elle est tardive, peut être doublement pénalisante.
27 L’action syndicale tend à s’arc-bouter sur la défense des acquis sociaux de la période fordienne sans prendre en compte la nature des changements dans la combinatoire productive tels que nous les avons décrits, ce qui l’empêche de trouver de nouveaux points d’appui pour faire valoir les intérêts des salariés et ici limiter les effets de leur aliénation. La montée en puissance d’une contestation syndicale des logiques financière et gestionnaire des entreprises ou de l’administration publique conduirait à ce que le bouclier des valeurs dominantes ne possède plus la légitimité facile qu’elles possèdent aujourd’hui, contribuant par là à une désaliénation des salariés. Mais cette contestation syndicale des stratégies économico-financières des entreprises ne trouve pas de soutien chez la plupart des salariés habitués à des luttes défensives sur des objets tangibles, autre manifestation de leur aliénation : les quelques succès remportés chez les cadres restent marginaux, justement en raison de la robustesse de la carapace des idées reçues parmi cette catégorie de salariés.
28 Une autre forme de résistance aux conditions présentes de l’aliénation – caractérisée en particulier par la mobilisation de la subjectivité – est lasimulation. D’une part, de plus en plus de salariés font semblant d’adopter les comportements attendus : après avoir tâtonné pour comprendre ce qui était souhaitable, ils se conforment aux normes comportementales, tant par le déclaratif que par des actes propositionnels ; mais ce n’est que façade, ces comportements adéquats permettant par ailleurs de « s’économiser » en disposant de l’aval de leurs maîtres... Selon nous, c’est ici la plus grande faiblesse du modèle productif émergent : largement basé sur l’évaluation des comportements, les salariés d’exécution tendent à simuler ce que l’on attend d’eux, autant dans les comportements que dans l’exécution des procédures lorsque celles-ci sont trop routinisées. De la même façon, leurs supérieurs immédiats perçoivent assez rapidement les simulations en question, sans toutefois disposer de moyens pour les mettre en évidence ou pour les combattre ; en les laissant se perpétuer, ils en deviennent complices, simulant à leur tour les comportements attendus vis-à-vis de leur propre hiérarchie. L’entreprise devient ainsi un grand théâtre d’ombres où les objectifs sont plus ou moins atteints mais surtout où les espaces d’autonomie sont conservés grâce à cette ingéniosité des uns et des autres pour maintenir les apparences du respect des normes comportementales, des règles productives (ceci est particulièrement vrai en matière de qualité, où les règles sont contournées dès l’obtention de la certification), des évaluations réciproques, etc. Bien sûr, tous ceux qui ne disposent pas durablement des ressources pour participer à ce grand jeu de la simulation sont exclus des groupes de pairs et bientôt de l’emploi. Par ailleurs, si cette simulation participe à l’accroissement de ce que les sociologues dénomment l’autonomie au travail, elle n’entame en rien l’aliénation du salarié, y compris dans le nouveau régime productif marqué par l’implication contrainte. La simulation relève des pratiques des « jeux sociaux » qui rendent le travail plus acceptable sans toutefois remettre en cause l’aliénation propre aux rapports de production capitalistes [21] M. Burawoy, Manufacturing Consent. Changes in the Labor...[21].
29 L’aliénation apparaît ainsi comme la cristallisation dans l’individu d’un cadre d’action collective, ou de pratiques sociales si l’on préfère, auquel il ne peut guère échapper : cette nécessité de s’y plier et plus encore celle de nier ce cadre appartiennent au processus de l’aliénation. Tout en refusant de glisser vers une sorte de déterminisme fonctionnaliste, il nous faut bien percevoir, avec Marx, qu’en possédant intrinsèquement les fondements de sa dénégation, l’aliénation du travailleur salarié constitue l’un des fondements de l’ordre social : les modalités présentes de mobilisation de la subjectivité dans l’activité de travail, contrairement à certaines attentes, ne font que renforcer les éléments constitutifs de sa négation.